Qu’est ce que la “dette cognitive”, cette conséquence d’une utilisation abusive de ChatGPT ?
- Par
Pollen
- Publié le
- 30/06/2025
- Temps de lecture
- 5min
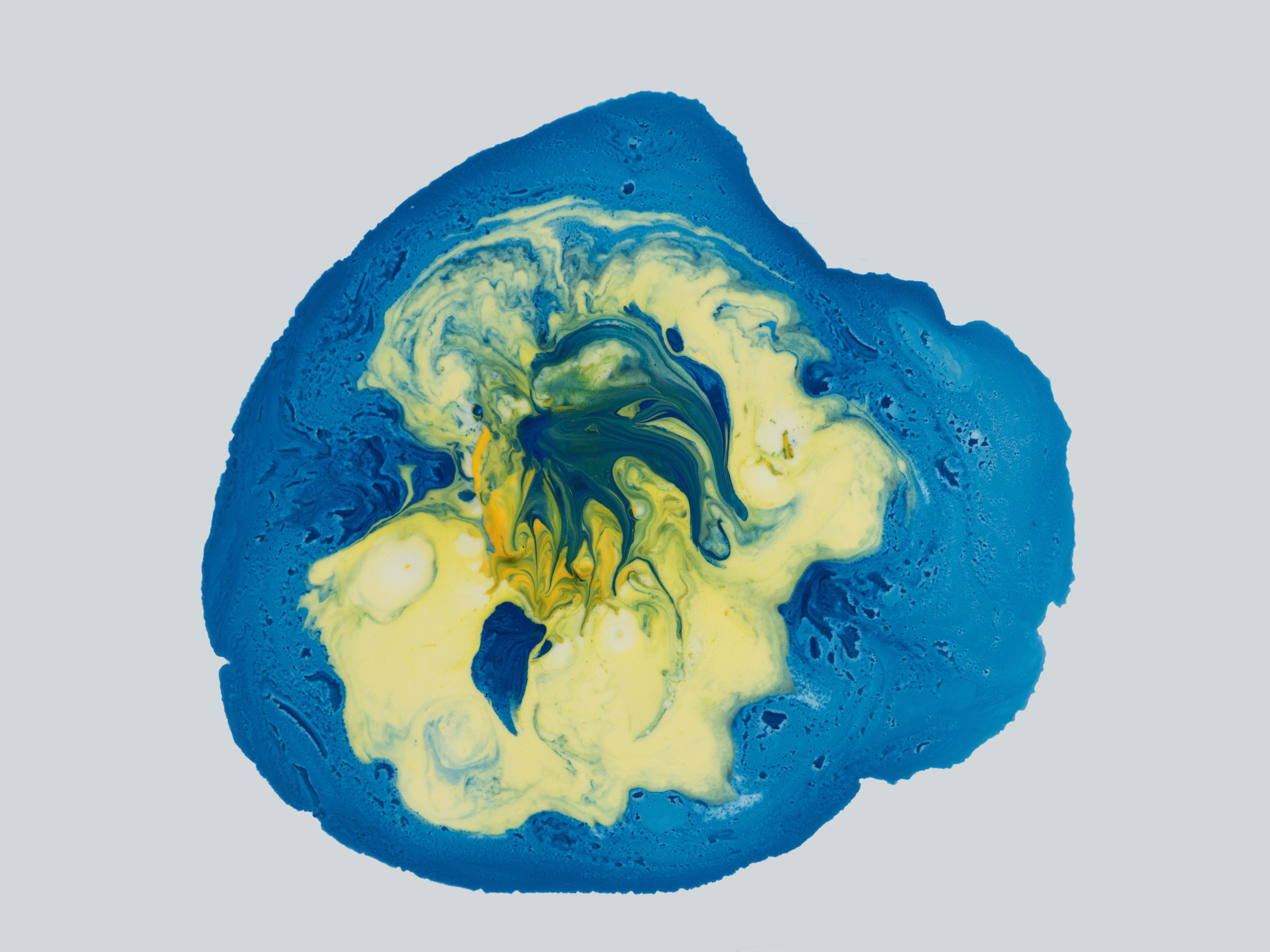
Ce serait, en quelque sorte, “le revers de la médaille”.
L’expression a été largement popularisée par le rapport du MIT qui a inondé LinkedIn au cours des dernières semaines.
Malgré son accent économique marqué, la “dette cognitive” est une conséquence bien intellectuelle : celle d’une utilisation régulière de l’IA.
Que nous dit l’étude ? Elle révèle qu’un usage régulier de ChatGPT pourrait avoir des répercussions importantes sur nos facultés cognitives et notre capacité à mémoriser l’information. Plus encore, la dette pourrait augmenter à mesure que nous déléguons nos efforts mentaux à l’IA, avec un impact significatif sur l’esprit critique, l’apprentissage et la capacité à réactiver notre cerveau.
L’expérience en bref : 3 groupes de travail, 0 pointé pour ChatGPT
Ils sont 54 participants, âgés de 18 à 39 ans, répartis en trois groupes de travail chargés de rédiger des essais :
- Le premier groupe est armé de ses seules connaissances.
- Le second est autorisé à utiliser des moteurs de recherche comme Google pour réaliser l’essai.
- Le troisième est amené à travailler sur des LLM (Large Language Model) comme ChatGPT.
L’expérience est répartie en 3 sessions programmées sur quatre mois. Chaque session de 20 minutes consiste à produire un nouvel essai sur un thème proche de ceux proposés au SAT (l’équivalent du BAC pour les étudiants américains). Des électroencéphalogrammes sont effectués pendant l’ensemble des sessions afin de mesurer l’activité du cerveau humain et les résultats sont unanimes.
Les utilisateurs de ChatGTP perdent à chaque fois. Activité cérébrale, capacité de mémorisation, créativité, esprit critique. Après la première session, 83% d’entre eux sont incapables de citer le moindre passage de l’essai qu’ils viennent pourtant de produire. Après 3 sessions ils sont encore 33% à ne pouvoir citer aucun passage de leur essai. À l’inverse les participants s’appuyant sur Google ou leurs connaissances personnelles ont presque tous été capables de citer un passage de leur essai dès la deuxième session.
Une dépendance douce qui nuit à l’apprentissage.
L’idée n’est sans doute pas si surprenante. Lorsque le réflexe IA s’installe, comme tout muscle qu’on cesse d’entraîner, le cerveau et les circuits cognitifs perdent en activité, et donc en élasticité.
Or l’apprentissage est affaire de répétition et d’échec.
Le cerveau crée des modèles mentaux basés sur les assomptions. Lorsque nous apprenons, nous validons certaines suppositions basées sur ces modèles et rejetons les suppositions fausses. Dans ce processus, les erreurs font partie intégrante de notre faculté à mémoriser.
L’IA nous évite justement cela : elle nous donne des réponses propres, polies, souvent pertinentes et sans friction. Mais en supprimant la confrontation et la difficulté, l’IA nous priverait aussi de ce que les pédagogues appellent “l’effort productif”, celui qui forge un raisonnement robuste et un apprentissage actif. La productivité immédiate serait donc inévitablement accompagnée d’une dette cognitive. Celle du cerveau qui ne mémorise plus et s’installerait avec le temps dans une paresse intellectuelle.

Ce que nous dit la 4ème session.
Mais, tout n’est peut-être pas si blanc ou noir. Entre performance immédiate et capacité d’innovation, l’IA apporte son lot d’opportunités et de défis, car parmi les 54 participants de l’étude, 18 volontaires ont participé à une 4ème session de travail au cours de laquelle les outils ont été transposés.
Les participants munis de leurs connaissances personnelles seules ont eu accès aux LLM, tandis que ceux qui réalisaient le travail sur ChatGPT n’ont eu pour seule ressource que leur cerveau.
Les résultats révèlent que :
- Les participants passant du LLM au cerveau seul ne retrouvent pas leur niveau d’engagement : leur activité cérébrale (alpha, beta) reste faible, tout comme leur capacité de rappel. Leur performance reste inférieure à celle du groupe “cerveaux uniquement”.
- Toutefois, ceux passant du cerveau seul au LLM montrent un engagement intellectuel élevé lorsqu’ils utilisent l’IA. L’utilisation de l’IA aurait ainsi permis au groupe de réactiver la mémoire et consolider le contenu originel.
L’IA comme amplificateur, jamais comme créateur ?
Si l’IA nous semble aujourd’hui capable d’écrire, coder, diagnostiquer ou conseiller, encore faut-il rappeler qu’elle ne pense pas. Elle n’a ni intention, ni intuition, ni conscience. Elle manipule des signaux, des données de contexte, mais jamais des idées.
C’est toute la thèse défendue par Luc Julia, co-créateur de Siri et l’un des experts les plus iconoclastes de sa génération. Dans son livre au titre provocateur L’intelligence artificielle n’existe pas, Luc Julia démonte une à une les projections hollywoodiennes qui entourent l’IA. Pour lui, ces systèmes ne font que traduire statistiquement la donnée du passé. Ils extrapolent, mais n’inventent rien. Ils assistent, mais ne comprennent pas. En cela, l’IA ne peut (et ne doit) rester que l’appanage de l’humain.
Une vision similaire a été récemment défendue par le rapport d’Apple Research, The Illusion of Thinking. Les LLM sont des modèles probabilistes qui tirent leurs forces de l’échelle. Ils prédisent le mot suivant mais n’ont jamais été dotées d’une quelconque capacité de raisonnement. Et c’est précisément cette illusion qui menace aujourd’hui les standards cognitifs, dès lors que nous nous mettons à prendre chacune des productions pour acquises.
Challenger la donnée et l’existant
Alors, ChatGPT et consorts nous rendent-il vraiment plus stupides ? Peut-être pas si les IA sont utilisées comme elles le devraient : des amplificateurs de brouillons et d’intuitions, mais jamais des substituts à la pensée.
Le défi des années à venir ne sera pas tant de réguler l’usage de l’IA, mais de s’y former, d’en comprendre les biais et les limites, de développer notre capacité à challenger l’existant et de poser les bonnes questions. Plus qu’un outil de production finale, l’IA s’impose comme un formidable assistant, capable “de lever l’angoisse de la page blanche”, de nous faire accéder à la connaissance en temps record. Dans ce contexte, la création resterait aux mains de l’humain, puisque le propre de l’intelligence n’est pas de restituer toute la connaissance disponible, mais bien d’inventer ce qui n’a jamais été imaginé par le passé.
